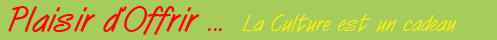
Negerin (Négresse)
Un intérieur miteux, tout en longueur, laisse percevoir la frugalité et la pauvreté d’un milieu socialement démuni.
L’appartement plongé dans la pénombre va quelque peu s’éclairer lorsque rentrent son occupante et sa masculine rencontre d’un soir.
Mais peut-on véritablement parler de lumière quand ce spectacle nous précipite dans la spirale de la cruauté, dans la fange glauque d’un abrutissement bestial où les sentiments s’expriment de manière simpliste (primaire ?), à grand renfort d’invectives, de sexe, de violence larvée (ou clairement visible).
Les textes de Franz Xaver Kroetz, figure majeure du théâtre allemand, se caractérisent, généralement, par une exploration de l’univers du prolétariat le plus démuni.
Ses personnages sont frappés d’une impossibilité presque totale à vraiment formuler oralement leurs émotions. Ils en paraissent comme totalement décalés, aphasiques, quasi autistes parfois.
Leur langage se réduit à une brièveté pour ainsi dire monocorde, à un phrasé haché et à de nombreux silences sensés en dire bien plus que de longues phrases alambiquées.
Cette fois encore, il fait de nous les spectateurs privilégiés d’un naufrage existentiel.
Ses sombres héros souffrent d’une blessure morale inguérissable, sans cesse aspergée au vitriol d’une vie exiguë uniquement rythmée par des pulsions irrépressibles et où l’insatiable besoin d’amour se résume à l’expression d’abrupte sexualité.
Brut de brut, le propos de Franz Xaver Kroetz se traduit en Negerin par le cocktail tristement classique d’un vocabulaire particulièrement cru assorti de menaces verbales, de coups, de vomissures, d’une fellation ou mieux d’une bruyante scène de sexe.
En délicat équilibre entre réalisme et exagération, ce huis clos suintant de sordide débauche et d’avilissement que l’on préférerait purement imaginatif interpelle, séduit et agace tout à la fois (comme toute vérité, non ?).
Si d’emblée, tous reconnaîtront le subtil jeu de Didier De Neck en clochard ivrogne et mari vicieusement retors, beaucoup percevront avec plus de difficultés toute l’ambivalence de la comédienne allemande Anne Tismer qui navigue adroitement entre fières retenues, audacieuses provocations et farouche résistance.
En effet, le spectateur non averti du style de l’auteur et ici metteur en scène allemand risque d’être irrité par cette interprétation sobre (parfois trop notamment dans le chef du jeune amant de Laurent Caron qui paraît presque mécanique et difficilement crédible).
Il faut donc passer outre cette barrière perceptive pour apprécier ce tragique portrait d’une sinistre, dangereuse et volontaire dérive.
Spectacle vu le 12-02-2009
Lieu :
Théâtre National - Grande Salle
Une critique signée
Muriel Hublet
Imprimer cette page
Enregistrer cette page sous format PDF